Thiron-Gardais
L'abbaye
de la Sainte Trinité
Mythe et réalité
se conjuguent pour faire de Thiron un haut lieu de spiritualité d'où
essaimèrent plus d'une dizaine d'abbayes et plus d'une centaine de prieurés
en France en Ecosse et en Angleterre. Ce rayonnement fut tel qu'on parlait de
l'Ordre de Thiron.
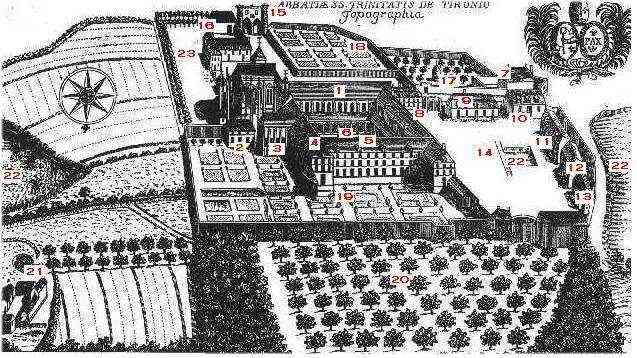 Au
XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation
et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques
disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu
absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire
à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir
à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,
très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus
porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries
contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de
Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de
fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église
du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce
à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye
fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre
ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité
et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés
lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent
et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres
de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,
pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au
début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait
: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,
fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation
de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna
de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.
Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à
servir d'école préparatoire à l'école militaire
de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père
n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils
dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants".
Au
XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation
et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques
disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu
absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire
à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir
à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,
très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus
porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries
contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de
Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de
fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église
du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce
à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye
fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre
ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité
et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés
lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent
et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres
de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,
pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au
début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait
: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,
fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation
de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna
de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.
Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à
servir d'école préparatoire à l'école militaire
de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père
n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils
dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants".
Pendant la Révolution,
l'abbaye fut de nouveau pillée et incendiée ; bien que l'église
fut rendue au culte dès
1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière
de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église
témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout
inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le
passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement
d'entendre sonner les vêpres ou matines.
dès
1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière
de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église
témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout
inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le
passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement
d'entendre sonner les vêpres ou matines.
L'église
L'église abbatiale
est classée Monument Historique. Construite en grès noir et en
moellon, elle se présente comme une vaste nef de 64 m de long sur 12
m de large, le magnifique chœur gothique flamboyant élevé
au XVème siècle s'étant effondré en 1817. Trois
fenêtres ont donc été percées sur la façade
est pour l'éclairer. Les verrières qui furent placées sont
de facture moderne, réalisées par un maître verrier de Chartres
suivant les techniques anciennes. A l'opposé, la façade ouest
présente, au-dessous des deux fenêtres obturées et garnies
de minces colonnes à chapiteaux, un portail en calcaire blanc à
deux archivoltes, fermés par une porte cloutée sur laquelle peut
se lire la date de 1618. Le clocher quant à lui date de la transformation
de l'abbaye en collège. On a substitué alors au discret toit de
tuiles à quatre pans qui le coiffait le lourd dôme d'ardoise que
l'on voit actuellement.
 Quelques
dates :
Quelques
dates :
- 1114 : Fondation de l'abbaye bénédictine
de Thiron par St Bernard de Ponthieu.
- XIIème siècle :
Construction de l'église du monastère : long vaisseau roman sans
bas-côtés, mais avec transept. Au sud, énorme tour trapue.
- XIIIème siècle :
Jean II de Chartres fait construire une grande partie des bâtiments du
monastère, notamment le chapitre.
- 1428 : Thomas de Montaigu, comte
de Salisbury, général en chef des troupes anglaises allant mettre
le siège à Orléans, incendie l'abbaye.
- Guillaume de Grimault (1431-1453),
puis son neveu, Léonnet de Grimault (1453-1498), restaurent en grande
partie l'abbaye et élèvent à leurs frais un magnifique
chœur gothique flamboyant.
- 1562 : Pillage du couvent
par 3000 cavaliers allemands à la solde des Huguenots.
- 1591 : Nouveau pillage par des
Suisses à la solde de Henri de Navarre. C'est Henri II de Bourbon, fils
naturel de Henri IV, qui est nommé abbé.
- 1629 : Réforme de la congrégation
de St Maur. Création du Collège Militaire et transformation générale
: le bras nord du transept sert de chapitre, le bras sud est aménagé
en cuisines, réfectoire et chambres.
- 1782 : Le bénéfice
de l'abbaye de Thiron est rattaché à la cure de St Louis de Versailles.
-1786 : Incendie qui détruit
la bibliothèque.
- 1791 : Fermeture de l'abbaye ;
bien national acquis par Etienne Taule qui démolit ce qui restait de
l'abbaye.
- 1802-1817 : L'aile occidentale
du collège s'effondre. Le plomb qui recouvrait les voûtes ayant
disparu à la Révolution, les basses voûtes s'effondrent
aussi en 1804 et 1805 ; enfin le chœur s'abat le 10 février 1817.
- 1982 : réfection
complète du sommet du clocher.
L'école
militaire
 Même
après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye
de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux
que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,
amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un
collège.
Même
après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye
de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux
que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,
amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un
collège.
Louis XIV lui accorda le titre d'Ecole
Royale Militaire, en fait une école de cadets avec le droit d'y envoyer
un certain nombre de soldats invalides à côté d'élèves
ordinaires internes ou externes. A la fin du XVIIIème siècle,
on comptait plus de 150 élèves pensionnaires sur un total de plusieurs
centaines d'élèves. Napoléon Bonaparte obtint une bourse
pour l'école de Thiron mais fit ses études à celle de Brienne.
Le collège
se composait de deux quadrilatères. Le premier, adossé à
l'église, comporte une belle maison bourgeoise avec une aile qui servait
de logement aux professeurs civils, avec chambres pour les élèves
dans les combles, le bras sud du transept effondré en 1801 qui comportait
les cuisines et le réfectoire, le bâtiment qui fait face à
la maison servant de classes. Le second quadrilatère, ou basse-cour,
prolongeait le premier avec les logements des domestiques et des remises.
La
Chapelle St Jacques
A l'occasion
des Rogations, le curé de Gardais était autorisé à
dire la messe au maître autel de l'église abbatiale. En 1762, l'abbé
de Thiron s'y opposa. Litige porté devant l'évêque de Chartres
: il donna au curé de Gardais l'autorisation d'édifier une chapelle
appelée "Croix St Jacques".
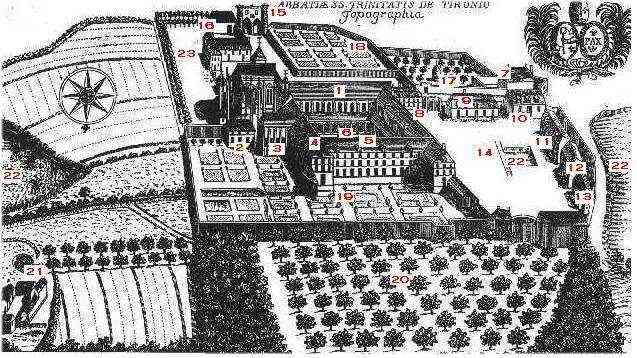 Au
XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation
et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques
disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu
absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire
à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir
à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,
très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus
porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries
contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de
Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de
fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église
du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce
à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye
fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre
ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité
et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés
lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent
et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres
de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,
pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au
début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait
: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,
fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation
de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna
de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.
Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à
servir d'école préparatoire à l'école militaire
de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père
n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils
dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants".
Au
XIIème siècle, recherchant un endroit propice à la méditation
et à la prière, St Bernard de Ponthieu se fixa, avec quelques
disciples, près de l'étang de Ste Anne et choisit "ce lieu
absolument abandonné et dénué de toute chose nécessaire
à la vie" pour fonder son monastère. Bernard souhaitait revenir
à la stricte observance de la Règle de St Benoît. Cependant,
très vite, son esprit de dépouillement et de pauvreté absolus
porta ombrage aux moines de St Denis de Nogent qui se perdirent en tracasseries
contre lui. Fort heureusement, la protection du célèbre Yves de
Chartres et de Rotrou III lui permit d'obtenir un nouveau domaine (charte de
fondation de 1114) : commença alors la construction de l'église
du monastère dont nous voyons aujourd'hui la longue nef romane. Grâce
à la réputation de sainteté de Bernard de Thiron, l'abbaye
fut soutenue par les Grands de l'époque tels que Henri 1er d'Angleterre
ou Louis VI le Gros ; très vite, elle connut la prospérité
et l'expansion. En 1145, quatorze abbayes et quatre-vingt-six prieurés
lui sont rattachés. Hélas, le temps et les années passèrent
et apportèrent heurts et malheurs : la guerre de Cent Ans puis les guerres
de Religion, enfin la mise en commende de l'abbaye signifièrent incendies,
pillages, mise à sac et aussi relâchement et déclin. Au
début du XVIIème siècle, une remise en ordre s'imposait
: c'est pourquoi, en 1629, Henri de Bourbon, le nouvel abbé commendataire,
fit venir à Thiron les bénédictins de la Congrégation
de St Maur pour y fonder un collège. Cette nouvelle affectation entraîna
de nombreux remaniements et la construction de bâtiments adaptés.
Un siècle plus tard, en 1751, le collège est habilité à
servir d'école préparatoire à l'école militaire
de Paris. Le jeune Napoléon y serait rentré si son père
n'avait pas jugé que c'était "envoyer là son fils
dans un pays perdu au milieu des bois et sans relation avec les vivants". dès
1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière
de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église
témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout
inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le
passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement
d'entendre sonner les vêpres ou matines.
dès
1795, le cloître et les bâtiments conventuels servirent de carrière
de pierre pour la construction des maisons du bourg. Si de nos jours seule l'église
témoigne de cette longue histoire, l'empreinte des moines est partout
inscrite dans la nature et se lit encore dans la pierre. Tout ici respire le
passé à tel point que le visiteur ne s'étonnerait nullement
d'entendre sonner les vêpres ou matines. Quelques
dates :
Quelques
dates :
 Même
après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye
de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux
que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,
amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un
collège.
Même
après la réforme de la congrégation de St Maur, l'abbaye
de Thiron périclite. Les fidèles bien moins généreux
que jadis, les libéralités des princes moins évidentes,
amènent à l'idée de fonder dans cette immense abbaye un
collège.